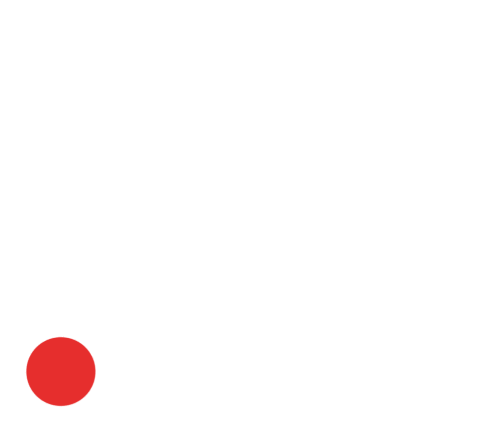Dans les rues du Grand Libreville, des étals de fortune jonchent le sol. Fruits, légumes, poissons ou viandes y sont exposés sans le moindre respect des normes d’hygiène. Cette pratique, de plus en plus répandue, constitue un véritable risque sanitaire pour les consommateurs. Entre contamination bactérienne, pollution de l’air et prolifération d’insectes, les dangers sont multiples.
Dans de nombreux marchés, notamment ceux situés dans les zones densément peuplées, qu’elles soient urbaines ou rurales, il est presque impossible de ne pas voir des vivres frais posés directement sur le bitume, souvent sans protection, au milieu de la poussière, des gaz d’échappement et des ordures. Une scène banale pour certains, mais un réel danger pour la santé publique.
Les sols urbains sont en effet des vecteurs de contamination, notamment par des substances chimiques (pesticides, hydrocarbures), des excréments d’animaux ou des agents infectieux. Pour de nombreux vendeurs, cependant, il s’agit du seul moyen de subsistance. « Je sais qu’il y a des marchés nouvellement construits à disposition des commerçants, mais le problème, c’est qu’il n’y a pas d’affluence. Du coup, les recettes ne suivent pas. C’est avec ce commerce que je nourris mes enfants. Si je ne vends pas, je suis foutue », explique Obone, commerçante.
Pour les clients, souvent parmi les plus démunis, ces marchés informels offrent un accès à la fois facile et surtout abordable à certains produits, à tel point que les risques sanitaires ne suffisent pas à les dissuader. Estimant que les prix proposés sont plus adaptés à leur budget, ils se tournent systématiquement vers ces vendeurs. Pourtant, l’exposition prolongée des aliments au soleil ou à l’humidité ne fait qu’aggraver les risques. « Ici, avec 5 000 francs, on peut avoir un peu de tout. Dans les grandes surfaces, avec cette somme, on ne peut pas tout acheter », témoigne Henriette Nsome, consommatrice.
Malgré les alertes répétées des autorités sanitaires, la pratique persiste. « Nous menons régulièrement des missions de contrôle qui se soldent par des saisies et, naturellement, des sanctions, car c’est une pratique interdite qui expose les produits à la contamination », affirme Jean-Delors Biyogue Bi Ntougou, directeur général de l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA). Néanmoins, la faible fréquence des contrôles et la rareté des sanctions favorisent la persistance de ces commerces informels, pourtant nuisibles à la santé des consommateurs.
« L’action de l’AGASA est relativement limitée, car nous appliquons uniquement des sanctions ponctuelles, principalement le retrait des produits. C’est à la mairie de veiller à ce que les commerçants ne s’installent pas dans les espaces non autorisés », ajoute-t-il. Outre l’hygiène douteuse, ces produits échappent souvent à tout contrôle : pas d’étiquetage, aucune date de péremption, et aucune information sur leurs conditions de production n’est disponible pour le consommateur.
Pour freiner l’expansion de cette pratique, il est impératif que les autorités compétentes intensifient les contrôles sanitaires, et que les consommateurs prennent conscience des risques encourus. Car derrière des prix attractifs ou une accessibilité apparente se cachent des dangers bien réels pour la santé. Préserver la sécurité alimentaire, c’est aussi lutter contre l’incivisme de certains commerçants et exiger des conditions de vente conformes aux normes d’hygiène.