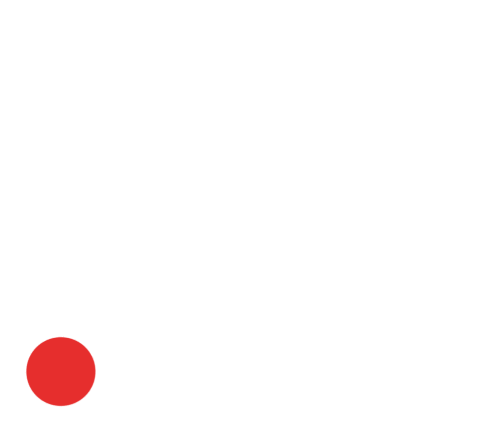Au Gabon, le « kongossa » désigne les ragots, potins ou commérages, souvent colportés de manière informelle dans les quartiers, les salons de coiffure, les taxis ou sur les réseaux sociaux. Perçu comme une facette familiale du quotidien et intégrée aux interactions sociales, il est généralement considéré comme anodin, voire amusant.
Pourtant, derrière ce qui semble n’être qu’un bavardage sans conséquence, se cache une pratique susceptible de tomber sous le coup de la loi. En effet, le kongossa, lorsqu’il porte atteinte à l’honneur, à la réputation ou à la vie privée d’autrui, par écrit ou via un support numérique, peut relever d’une infraction pénale, passible d’une peine allant jusqu’à un an d’emprisonnement et d’une amende pouvant atteindre 1 000 000 de francs CFA.
Le Code pénal gabonais, révisé en 2020, encadre clairement ce type de comportement. L’article 283 en donne la définition. « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle elle est imputée est une diffamation ». Autrement dit, même sans propos injurieux ou termes grossiers, toute affirmation susceptible de nuire à la réputation d’une personne peut être considérée comme diffamatoire. Il suffit que cette parole atteigne la dignité ou l’image de l’autre pour tomber sous le coup de la loi.
L’article 284 précise les sanctions encourues : « Quiconque, hors les cas prévus aux dispositions du livre II du présent Code, se rend coupable de diffamation envers un particulier, par discours, cris ou menaces proférées dans des lieux ou réunions publics, soit par des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des pancartes ou affiches exposés aux égards du public soit, est puni d’un emprisonnement de un an au plus et d’une amende de 1 000 000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement ».
Cette disposition s’applique à une large variété de supports : publications sur les réseaux sociaux, messages vocaux dans des groupes WhatsApp, vidéos partagées, commentaires en ligne, propositions tenues lors d’un direct, voire affiches exposées dans un commerce. Dès lors qu’un tiers peut entendre ou lire votre proposition, vous entrez dans le champ du public, donc de la loi.
Il ne faut pas non plus négliger l’injure, abordée à l’article 286 : « Toute expression outrageante, terme de mépris ou d’invective qui ne contient l’imputation d’aucun fait est une injure. Hors les cas prévus aux dispositions du livre II du présent Code, l’auteur de l’injure commise envers les particuliers, dans les conditions constituées à l’article 284 ci-dessus est, lorsqu’elle n’a pas été précédée de provocation, punie d’un emprisonnement de six mois au plus et d’une amende de 1 000 000 de francs au plus ou de l’une de ces deux peines seulement ». Cela signifie que même une moquerie, un surnom humiliant ou une remarque cinglante peut être réprimée pénalement si elle est proférée en public, déterminant de l’intention initiale.
Le Code va plus loin encore avec l’article 157, relatif à l’outrage. « Toute atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps dépositaire de l’autorité publique commise par paroles injurieuses, diffamantes ou menaçantes, écrits, dessins, images de toute nature ou gestes, constitue un outrage ». Insulter ou mépriser publiquement un policier, un agent de l’État, un magistrat ou un élu exposé donc à des poursuites renforcées, car l’infraction est jugée plus grave lorsqu’elle vise l’autorité publique.
À l’ère du numérique, où une opinion peut devenir virale en quelques minutes, la prudence est plus que jamais de mise. Une simple remarque lancée dans un groupe privé peut être capturée, diffusée, et servir de preuve devant la justice. Ce qui relevait autrefois du bouche-à-oreille restreint est désormais exposé aux regards de tous. Et cette exposition fait toute la différence aux yeux de la loi.
Il est donc impératif de comprendre que la liberté d’expression ne donne pas le droit d’atteindre la réputation d’autrui. Donner son avis n’est pas un problème en soi. Ce qui est problématique, c’est de le faire au détriment de la vérité, de l’honneur ou de la dignité d’un tiers. Le fait d’avoir relayé une information non vérifiée, ou de commenter des faits privés sans y être impliqué, peut suffire à engager sa responsabilité pénale.
Ce cadre juridique appelle à une véritable prise de conscience collective. Le Kongossa n’est pas toujours drôle, ni inoffensif. Il peut devenir un acte répréhensible, voire criminel, lorsqu’il franchit certaines limites. Se taire, ou s’abstenir de commenter ce qui ne nous regarde pas, n’est ni une lâcheté ni une faiblesse. Dans bien des cas, c’est une preuve de discernement.
Aujourd’hui, les bavardages sont amplifiés, archivés, analysés. Chacun, du journaliste au simple utilisateur de réseaux sociaux, doit apprendre à peser ses mots. Dans un monde où les mots ont une valeur juridique, le kongossa peut coûter bien plus qu’un simple malentendu. Cela peut coûter votre liberté.