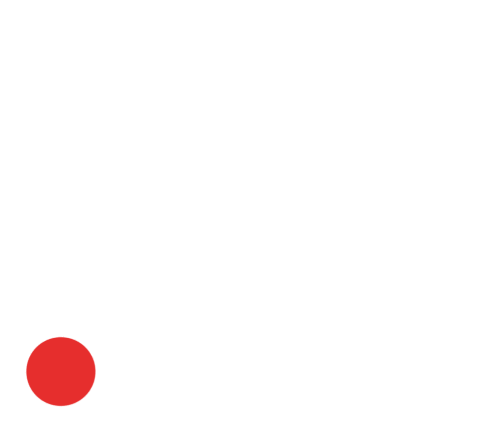Dans les rues de Libreville, Port-Gentil ou Franceville, les étals de nourriture s’alignent à chaque coin de rue. « nikes », beignets, brochettes, riz ou poissons : la street food fait partie du quotidien de milliers de Gabonais. Accessible, rapide et bon marché, elle nourrit les travailleurs pressés, les étudiants, les noctambules. Mais derrière cette convivialité et cette facilité se cache une réalité inquiétante : la nourriture de rue, telle qu’elle est souvent vendue, devient un véritable danger pour la santé publique.
Dans beaucoup de points de vente, l’hygiène laisse à désirer. Les aliments sont exposés à l’air libre, entourés de mouches ; l’eau utilisée pour la cuisson ou le lavage des ustensiles provient parfois de sources douteuses ; les restes de la veille sont réchauffés plusieurs fois, au mépris des normes sanitaires les plus élémentaires. Résultat : les intoxications alimentaires se multiplient, tout comme les maladies diarrhéiques, les infections intestinales ou les cas de typhoïde.
Selon un cabinet de nutrition et diététique, « la majorité des pathologies digestives que nous observons en milieu urbain sont liées à la consommation d’aliments mal conservés ou mal cuits. Ces plats de rue, souvent préparés dans des conditions précaires, favorisent la prolifération bactérienne et la contamination croisée. À long terme, cela peut aussi affaiblir le système immunitaire et entraîner des troubles chroniques ». Le danger est d’autant plus grave que ces maladies ne sont pas toujours immédiatement visibles. Elles s’installent parfois lentement, affaiblissant l’organisme au fil du temps. D’où l’expression que certains médecins n’hésitent plus à employer : « la street food, un tueur silencieux ».
La réponse à cette situation tient en trois mots : prix, praticité et habitudes. Manger dehors coûte souvent moins cher que cuisiner à la maison, surtout pour les travailleurs aux revenus modestes. Un plat de « poulet beignets » peut se trouver à 1000 francs, là où le même repas coûterait le double, voire plus s’il fallait acheter tous les ingrédients.
S’ajoute à cela le manque de temps et de moyens matériels : beaucoup n’ont ni cuisine équipée, ni électricité stable, ni réfrigérateur pour conserver leurs aliments. Enfin, la street food, c’est aussi une culture, un lieu de vie et de partage. On y rit, on y débat, on y refait le monde autour d’un plat fumant.
Face au danger, certains appellent à interdire purement et simplement la vente de nourriture dans la rue. Une approche simpliste, qui ignorerait la réalité économique : la street food fait vivre des milliers de familles. Plutôt que d’interdire, il faut encadrer.
Des formations et des normes d’hygiène alimentaire devraient être rendues obligatoires pour toute activité de restauration de rue, avec un suivi régulier des services sanitaires. Les municipalités pourraient aménager des espaces dédiés, équipés en eau, électricité et assainissement, afin d’assurer un environnement plus propre et contrôlé. Les citoyens doivent aussi jouer leur rôle, en choisissant mieux où ils mangent et en exigeant de la qualité. Enfin, soutenir les initiatives qui mêlent authenticité, sécurité et entrepreneuriat féminin ou jeune permettrait de faire de la street food un secteur à la fois sûr et rentable.
Au Gabon, la street food n’est pas un problème en soi. C’est un pan de notre culture culinaire, un espace d’expression et de survie économique. Mais si rien n’est fait pour en corriger les dérives, elle continuera à faire des victimes invisibles. Le vrai défi, c’est donc d’apprendre à concilier plaisir et sécurité, pour que manger dans la rue reste une expérience populaire, mais plus jamais mortelle.