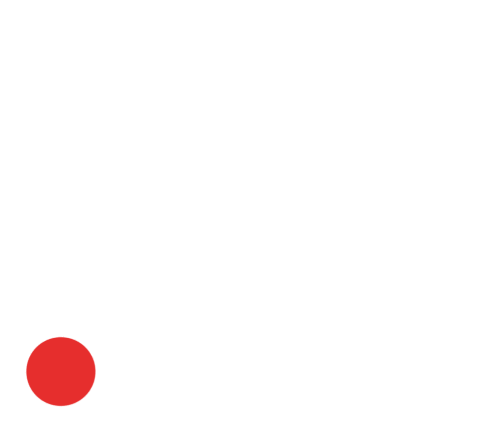Inscrit dans la Constitution, l’article 37 alinéa 2 dispose que « l’État garantit à tous l’accès à l’eau potable et à l’énergie ». Un engagement fort, censé traduire la volonté de l’État de répondre aux besoins essentiels des citoyens. Mais entre le texte et la réalité, le contraste est saisissant.
À Libreville comme dans de nombreuses localités de l’intérieur du pays, le quotidien de milliers de familles est marqué par les coupures d’électricité et le manque d’eau potable. Les scènes sont familières : des habitants contraints de se lever à l’aube pour remplir quelques bidons avant que la pression d’eau ne chute, des étudiants révisant à la lueur d’une bougie, des commerces paralysés par les délestages.
Pourtant, l’accès à l’eau et à l’énergie ne relève pas du luxe. Ce sont des droits fondamentaux, reconnus par la loi suprême du pays, la Constitution. Leur absence ne se traduit pas seulement par de l’inconfort, mais par une atteinte directe à la dignité humaine. Comment envisager le développement, la santé publique ou l’éducation lorsque ces besoins vitaux demeurent incertains ?
Malgré les multiples annonces de projets de modernisation et d’investissements dans les infrastructures, la situation peine à s’améliorer. Le Gabon dispose pourtant d’un potentiel hydraulique et énergétique considérable. Ce paradoxe interroge : comment un pays aussi riche en ressources naturelles peut-il encore peiner à garantir à tous un accès stable à l’eau et à l’électricité ?
Le droit existe… mais sous conditions
Pour nuancer ce constat, le juriste constitutionnaliste Arnaud Patrick Ebang explique. « L’article 37 alinéa 2 consacre un droit fondamental, mais son exercice pratique n’est pas automatique. Si le manque d’eau ou d’électricité résulte d’une défaillance ou du refus de l’État ou de la société adjudicataire, les citoyens peuvent déposer un recours devant le Conseil d’État pour faire valoir leurs droits. En revanche, si la pénurie est causée par un élément naturel, une baisse du niveau d’eau d’un barrage ou un endommagement accidentel du matériel, aucune procédure judiciaire ne peut être engagée. ».
Cette précision permet de mieux comprendre la situation : même si le droit à l’eau et à l’électricité est garanti par la Constitution, certaines familles peuvent rencontrer des coupures. Ces interruptions sont parfois dues à des contraintes techniques ou à des procédures administratives, tandis que d’autres relèvent de la responsabilité de l’État ou des prestataires privés. Savoir identifier la cause permet aussi de mieux réagir et de connaître les démarches possibles pour rétablir le service.
Garantir ces droits, ce n’est pas simplement respecter la Constitution, c’est assurer la justice sociale, la sécurité sanitaire et la cohésion nationale. Tant que cet article 37 alinéa 2 restera une promesse non tenue, c’est la crédibilité de l’État qui s’en trouvera affaiblie. Parce qu’au Gabon, en 2025, on ne devrait plus avoir à prier ou espérer pour qu’il y ait de l’eau au robinet ou de la lumière à la maison.