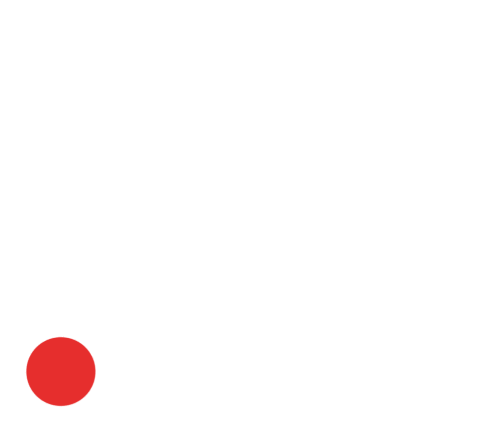« Nous nous donnons deux ans pour que les problèmes de délestage et d’accès à l’eau soient résolus ». Cette déclaration d’Alexandre Barro Chambrier, Vice-président du gouvernement, lors d’une interview à RFI le 17 mai 2025, sonne comme un engagement solennel. Deux ans pour en finir avec les coupures et garantir un accès stable à l’eau potable. Un pari audacieux, mais indispensable, tant ces besoins pèsent sur le quotidien des gabonais.
Depuis des années, l’eau et l’électricité sont devenues synonymes d’inégalités et de frustrations. Coupures prolongées, absence de desserte dans certains quartiers, infrastructures vétustes : les défis sont nombreux. Mais le gouvernement entend bien faire de cette situation un mauvais souvenir, en plaçant ce chantier au cœur de son action.
C’est tout le sens de la création du ministère de l’Accès universel à l’eau et à l’énergie, bras armé de cette ambition avec à sa tête Phillipe Tonangoye. Sa mission est double : restaurer l’existant et bâtir l’avenir. Il s’agit de moderniser les réseaux, sécuriser les capacités de production, diversifier les sources, et surtout faire en sorte que plus aucun citoyen ne soit laissé pour compte. La stratégie s’appuie sur des projets concrets, comme l’interconnexion régionale, l’exploitation du gaz et de l’hydroélectricité, ou encore l’accélération du programme PIAEPAL pour l’eau dans le Grand Libreville.
Ce volontarisme est désormais soutenu par un socle juridique fort : la nouvelle Constitution du Gabon, adoptée par référendum durant la transition, consacre l’accès à l’eau et à l’énergie comme des droits fondamentaux. L’article 37 dispose que « l’État garantit à tous l’accès à l’eau potable et à l’énergie ». Autrement dit, ce ne sont plus de simples services publics, mais des engagements inscrits dans la loi, auxquels l’État est tenu.
La mission est titanesque, et le compte à rebours est lancé. Deux années pour relever un défi qui touche au quotidien de milliers de gabonais. Si les autorités promettent des résultats rapides, elles devront d’abord surmonter un passif lourd : infrastructures vétustes, zones encore non raccordées, absence de maintenance préventive. Mais cette fois, l’exécutif affiche une volonté claire, adossée à une feuille de route ministérielle dédiée. Chaque geste compte désormais : réparer, raccorder, étendre. Car au bout de chaque canalisation, de chaque ligne électrique, il y a une attente bien réelle celle d’un peuple lassé d’espérer.
Au-delà du constat, il y a aussi une fenêtre d’opportunité. Ce délai de deux ans pourrait devenir le catalyseur d’un changement de cap historique, à condition de maintenir le cap et d’impliquer les citoyens. Avec un encadrement constitutionnel renforcé, des engagements politiques assumés et des partenaires techniques en appui, les bases d’un redressement durable sont posées. Si les efforts s’intensifient et si les résultats se font sentir sur le terrain, l’eau et l’électricité ne seront plus des privilèges incertains, mais des biens communs enfin accessibles. Une nouvelle ère peut commencer à condition que la promesse devienne action, et que l’action tienne parole.