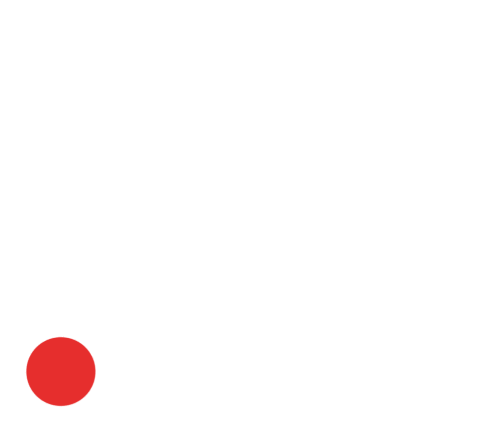Longtemps symbole de respect et de lien entre deux familles, la dot tend aujourd’hui à se transformer en instrument de marchandage. Le niveau d’instruction de la femme, jadis secondaire, devient une véritable monnaie d’échange, soulevant des interrogations sur la place accordée à la femme dans la société.
Au Gabon, la dot reste une tradition profondément ancrée dans les mariages coutumiers. Mais cette pratique ancestrale prend une tournure préoccupante. « Aujourd’hui, un père qui a envoyé son enfant faire des études à l’étranger estime que sa fille a une valeur ajoutée qu’elle apportera à sa belle-famille et réclame donc une compensation », explique Tah Mombo, chercheur praticien bwitiste. Désormais, le niveau d’instruction de la future épouse ne se limite plus à une fierté familiale : il devient un argument monnayé dans les négociations, parfois au même titre que la beauté ou la fertilité.
Autrefois, la dot se fondait sur d’autres critères. « Elle n’était pas associée à un cursus scolaire, car cela n’existait pas. On s’appuyait sur la qualité de la femme : de quelle famille venait-elle ? Quels en étaient les ascendants ? Y avait-il compatibilité entre les deux familles ? », rappelle le traditionnel. Mais depuis plusieurs années, les diplômes sont désormais évalués, chiffrés et intégrés aux exigences financières. Certaines familles perçoivent ainsi l’éducation de leur fille comme un investissement susceptible de générer une dot plus élevée.
La promotion de la scolarisation des filles s’accompagne donc d’un paradoxe : leur réussite académique est parfois instrumentalisée pour justifier des dots exorbitantes. Une jeune femme titulaire d’un master ou d’un doctorat peut voir sa dot multipliée par deux, voire trois, par rapport à une femme sans diplôme. « Ma fille est intelligente, elle a obtenu une bourse d’excellence pour la France, elle détient un master en finance et travaille dans une banque de la place. Ce n’est pas de la prétention, mais cela mérite une dot à la hauteur de son statut », affirme un père de famille. Pour lui, il ne s’agit pas de « vendre sa fille », mais de faire reconnaître l’investissement consenti pour son éducation.
Si certains y voient une juste reconnaissance de l’effort des parents, d’autres dénoncent une logique perverse qui transforme la femme instruite en capital social à rentabiliser. « Cette pratique est dangereuse car elle valorise l’intérêt matériel et non l’humain. Des personnes de classes sociales différentes ne pourront plus s’unir, et cela s’apparente à une forme de vente », prévient Tah Mombo. Le chercheur s’inquiète : « Cette manière de faire s’apparente à une vente aux enchères, alors que la cérémonie de dot est censée symboliser un échange. Cela pourrait devenir un problème pour notre culture, qui risque de disparaître sous le poids de cette dérive ».
Un vide juridique propice aux abus
Bien qu’adoptée par le Sénat en décembre 2020, la proposition de loi visant à encadrer le mariage coutumier au Gabon n’est toujours pas entrée en vigueur. « En cas de décès ou de séparation, nous n’avons aucun droit reconnu sur les biens de notre conjoint, parfois même sur nos propres enfants », déplore Micheline N’gôh, mère de deux enfants, mariée à la coutume depuis trois ans. En l’absence de cadre légal, ni les épouses ni les enfants ne disposent d’une réelle protection juridique. Par ailleurs, aucun plafond n’est fixé pour la dot, laissant libre cours aux excès.
Certaines familles profitent de cette situation pour imposer des sommes démesurées. « La famille de ma fiancée m’a réclamé plus de 2 millions de francs CFA, sans compter les biens matériels et frais annexes. J’ai dû m’endetter lourdement », confie André Engonga, encore marqué par cette épreuve.
Une dérive aux multiples conséquences
Le phénomène dépasse la simple dimension économique : il réduit la femme à un objet de valorisation sociale. Dans certains cas, il ouvre la voie aux violences conjugales, car certains hommes estiment avoir « payé le prix » et s’arrogent ainsi tous les droits. « Deux ans après mon mariage, je n’arrivais pas à concevoir. Cela m’a valu insultes et coups de la part de mon ex-conjoint, qui considérait avoir investi et voulait un retour sur investissement », témoigne Mabaka Ambroisine.
Si, pour certains, cette évolution traduit une forme de reconnaissance du mérite de la femme, elle interroge sur le fond : l’émancipation des femmes peut-elle réellement s’accomplir lorsqu’elle est instrumentalisée par des logiques marchandes ? En transformant l’éducation en critère de négociation, la société gabonaise risque de glisser vers une surenchère matrimoniale où amour et respect s’effacent derrière l’argent.