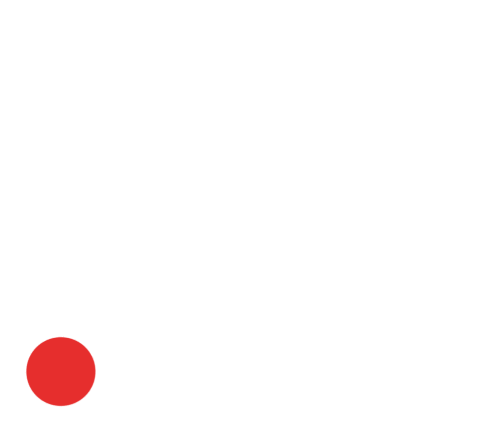Le phénomène du retour aux sources chez les jeunes générations a connu un essor considérable ces dernières années. On observe un intérêt renouvelé pour les us et coutumes ancestraux, incluant parfois des rites autrefois dépréciés ou délaissés. Un débat intense anime la société quant à la nature de ce mouvement : s’agit-il d’un simple effet de mode ou d’une véritable quête identitaire ?
Dans un monde en perpétuelle mutation, marqué par la globalisation, l’omniprésence du numérique et une certaine forme de consommation excessive, de nombreux jeunes optent désormais pour un retour à leurs racines. Cela se manifeste par une préférence pour les produits du terroir, la revalorisation des traditions, la pratique de rites spirituels anciens, ou encore l’apprentissage des langues locales.
Ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes qui, parfois confrontés à des questionnements identitaires, se tournent vers ces pratiques traditionnelles. À cette démarche personnelle, voire existentielle, s’ajoute une tendance croissante au sein de la société gabonaise à promouvoir activement les coutumes, notamment par le biais de festivals, la valorisation de l’artisanat et de la gastronomie locale.
Selon Roger Nguema-Obame, enseignant-chercheur au département de sociologie à l’Université Omar Bongo (UOB), « l’adhésion aux rites anciens pourrait en effet être motivée par une certaine angoisse existentielle, un sentiment d’insécurité, ou encore un désenchantement vis-à-vis des religions instituées, qui auraient pu donner le sentiment d’avoir trahi leurs promesses ». L’expert affirme qu’il s’agit là « d’individus en quête de sens face à certaines situations ».
Ce mouvement, explique-t-il, se manifeste souvent dans des discours politiques et sociologiques où la valorisation des identités locales et des diversités culturelles prend une place prépondérante. « Nous pouvons en effet être face à une diversité de situations », souligne-t-il, citant par exemple « ceux qui font un usage instrumental des rites et des croyances du Gabon pour atteindre des objectifs bien précis ». Pour une grande partie des concernés cependant, ce retour aux traditions semble devenir une nécessité pour la préservation de leur héritage culturel face aux menaces de l’homogénéisation mondiale.
Loin de freiner cette tendance, les réseaux sociaux en sont parfois de puissants catalyseurs. Sur des plateformes comme Instagram, TikTok ou Facebook, les partages d’expériences et de savoir-faire abondent. « Je regarde beaucoup de contenus culinaires. Grâce aux recettes publiées sur les réseaux sociaux, je deviens peu à peu un véritable cordon bleu », déclare Gervina Bouka. Le retour à la vie rurale, à la cuisine traditionnelle et à bien d’autres pratiques ancestrales connaît un regain d’intérêt, souvent porté par des influenceurs qui remettent au goût du jour des savoir-faire parfois délaissés au profit de la modernité ou d’influences extérieures.
Le retour aux sources ne saurait donc être réduit à un effet de mode superficiel. Il apparaît comme un processus dynamique, enraciné dans les réalités contemporaines et les aspirations profondes des individus à se reconnecter à leur héritage. Ce mouvement témoigne d’une volonté collective de redécouvrir les fondements de l’identité, tout en dialoguant avec les exigences et les apports du monde moderne.