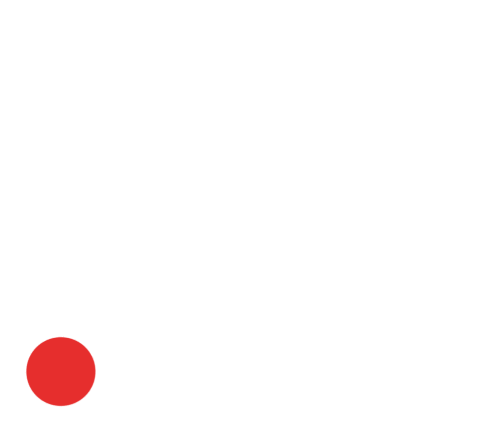Dans les quartiers populaires du grand Libreville, tel que Nzeng-Ayong, PK12, Akébé, Lalala pour ne citer que ceux-là, une réalité émerge du quotidien des populations. Les points de deal, ces lieux, souvent connus de tous mais rarement dénoncés, représentent des zones grise où se mêlent économie souterraine, tensions sociales et angoisse permanente.
À l’ombre d’un arbre, dans un hangar, une bâtisse abandonnée, ou parfois même chez le boutiquier du coin, dans les quartiers, chacun sait où se trouve le point de deal, vulgairement appelé « Bouenzet ».
Les riverains y viennent discrètement, les va-et-vient sont constants. Pourtant, le silence est la règle, et parler, c’est s’exposer.
« Nous sommes tous au courant de ce qui se passe, mais on fait comme si on ne voyait rien et on se tait », confie sous anonymat une habitante de Nzeng-Ayong.
La méfiance règne, tout comme la peur des représailles. Et pour les plus bavards, leur quotidien devient un enfer.
L’oisiveté qui règne au sein de ces quartiers laisse peu d’alternatives à beaucoup. Pour certains, entrer dans le petit commerce de la drogue devient un choix par défaut, parfois encouragé par un voisin, un cousin ou un ami.
« C’est à cause du chômage que j’avais commencé à faire ça, ma go était enceinte, il fallait que je m’occupe d’elle et c’était l’alternative la plus simple qui s’offrait à moi » a déclaré un anonyme.
Le Cannabis, le cailloux, le kéméka, le tramadol, appelé encore Cobolo, des noms propres aux consommateurs locaux, circulent discrètement dans ces quartiers d’un jeune à un autre.
« Ce n’est pas une vie qu’on choisit, c’est une vie qu’on subit », affirme un jeune de 22 ans rencontré à Nzeng-Ayong un quartier du 6e arrondissement de Libreville, qui dit travailler dans ce qu’il appelle une entreprise familiale.
D’abord consommateur puis vendeur dès l’âge de 16 ans, il a troqué stylos et cahiers pour les cachets et autres produits de contrebande, pour « tenir le coin » et estimer, gagner entre 10 000 à 20 000 FCFA par jour.
Face à ce constat, les autorités militaires prennent des mesures, descente de terrain inopiné, démantèlement de réseau, fouille dans les quartiers. Seulement une fois partie, le trafic reprend de plus belle.
En cause, ces descentes policières sporadiques. Les arrestations ciblent souvent les « petits » vendeurs tandis que les véritables commanditaires de ces réseaux sont très rarement inquiétés. D’aucuns soupçonnent des complicités au sein même de la cellule familiale, au sein l’appareil judiciaire, des forces de l’ordre et de l’administration locale.
Mme Justine, habitante de Plaine Orety affirme : « Quand vous touchez à ces enfants, vous touchez à des investissements familiaux. Ici, ce sont des familles entières qui travaillent à la chaîne ».
Le manque de réactivité de certaines autorités, ajouté à la complicité de certains habitants de ces quartiers, empêche généralement toute action durable.
En plus de l’insécurité ambiante, les habitants vivent parfois dans la peur d’un règlement de comptes entre bandes rivales ou simplement d’être pris pour cible à tort. Et très souvent, elles deviennent les premières victimes de ce trafic.
« Parfois, ils se battent avec des objets coupants mettant les passants en danger, ils appellent ce rite instaurés le respect » a révélé une anonyme.
Et ce phénomène ne se limite pas seulement aux jeunes hommes, la gent féminine est, elle aussi, négativement impacté par ce climat social délétère.
« Quand j’ai perdu mon père, je n’avais plus personne sur qui compter, mes amis sont devenus ma seconde famille, ils m’ont appris à écrouler les produits » a déclaré une anonyme.
Elles sont parfois entraînées dans des cercles de consommation, elles deviennent les objets sexuels de ces contrevenants en échange d’une dose.
Malgré ce trafic, dans ces quartiers, la vie continue. Entre responsabilité professionnelle pour les uns, responsabilité social pour les autres et occupations scolaires pour les plus jeunes, chacun continue de vaquer à ses occupations, seulement le silence, lourd et pesant, lui reste omniprésent.