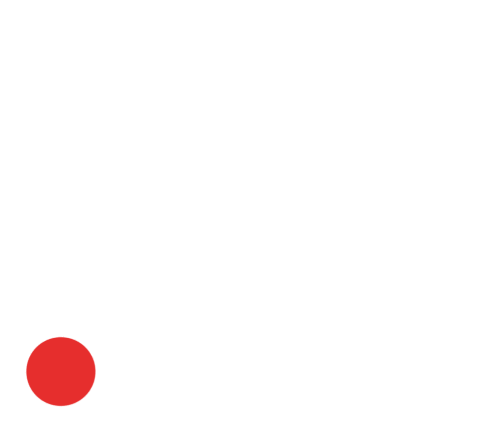Au Gabon, les produits éclaircissants contenant des substances toxiques continuent de circuler malgré un arsenal juridique de plus en plus strict. Entre marché informel, réseaux sociaux et boutiques en ligne, la commercialisation de cosmétiques interdits reste un phénomène difficile à enrayer. Pourtant, la loi gabonaise ne laisse aucune zone grise : la vente de ces produits est illégale et sévèrement sanctionnée.
Depuis l’Arrêté n°000002/MSAS/CAB du 11 octobre 2023, toute mise sur le marché de cosmétiques contenant du mercure ou d’autres composants dangereux est strictement prohibée. Ces mesures visent à protéger les consommateurs d’ingrédients extrêmement nocifs, capables d’endommager la peau, les reins, le système nerveux et d’entraîner des intoxications sévères.
Le Code pénal renforce cette protection : l’article 361 permet d’assimiler la vente de produits éclaircissants toxiques à une atteinte à l’intégrité physique. Les vendeurs encourent jusqu’à cinq ans de prison et 50 millions de francs CFA d’amende. Une sanction qui traduit la gravité de l’enjeu sanitaire.
Le commerce en ligne, nouveau refuge des vendeurs
Avec l’essor du numérique, la distribution de ces produits bascule de plus en plus sur les réseaux sociaux et les plateformes de vente en ligne. Pour répondre à cette évolution, la Loi n°027/2023 du 11 juillet 2023 sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité s’attaque désormais à la vente électronique de substances interdites.
L’article 69 est explicite : proposer ou mettre à disposition un produit illicite par voie électronique expose à cinq ans d’emprisonnement et 10 millions de francs CFA d’amende. Les vendeurs en ligne, tout comme les plateformes qui hébergent ces contenus, sont désormais pleinement responsables.
Le “Kwandza”, une pratique persistante et dangereuse
Malgré ces interdictions, la dépigmentation volontaire, communément appelée « Kwandza », demeure très répandue. Cette pratique, alimentée par des normes esthétiques préjudiciables où la peau claire est perçue comme un signe de beauté ou de réussite, continue d’attirer de nombreux consommateurs.
Les produits éclaircissants contenant du mercure, souvent vendus sous couvert de “résultats rapides”, provoquent pourtant : brûlures et dégradations sévères de la peau ; insuffisances rénales ; troubles neurologiques et affaiblissement du système immunitaire.
Les utilisateurs ignorent souvent la composition exacte de ce qu’ils appliquent sur leur peau, tandis que certains vendeurs minimisent les risques ou dissimulent volontairement les ingrédients.
Informer, contrôler, responsabiliser : un chantier national
Au-delà des lois, la lutte contre les produits éclaircissants toxiques exige un effort collectif. L’Agence gabonaise de normalisation (AGANOR) doit renforcer ses contrôles et veiller à la conformité des produits présents sur le marché. Les campagnes de sensibilisation doivent, elles, cibler les consommateurs souvent mal informés.
Le défi est également culturel : tant que certaines représentations sociales valoriseront la peau claire, le marché parallèle trouvera preneur. Il est essentiel de promouvoir une vision saine, inclusive et réaliste de la beauté.
Une bataille qui se joue autant dans les consciences que devant la loi
La lutte contre le « Kwandza » n’est pas seulement une question de sanctions. C’est un combat pour la santé publique, pour l’estime de soi et pour la protection des citoyens. Interdire ne suffit pas, il faut comprendre, prévenir et accompagner. Le véritable changement commencera lorsque la société choisira de valoriser toutes les carnations et refusera que la beauté devienne un danger.