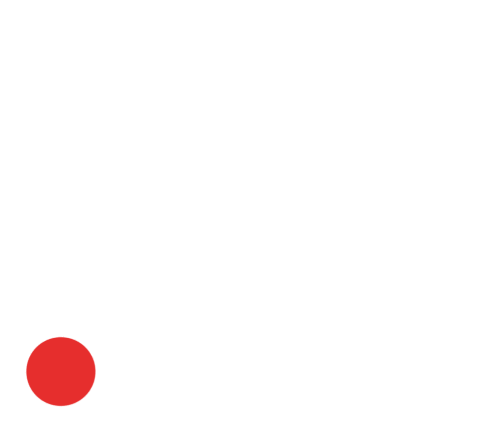Le devoir d’humanité est-il toujours respecté dans nos rues, sur nos lieux de travail, ou même au sein de nos familles ? Cette question, au cœur de la conscience collective, se heurte au strict cadre juridique de la non-assistance à personne en danger, une infraction que le Code pénal gabonais réprime avec fermeté.
Ce délit d’omission, souvent éclipsé par les crimes d’action, rappelle à chaque citoyen qu’une simple inaction peut avoir des conséquences judiciaires graves et, pire encore, coûter une vie.
La loi gabonaise ne se contente pas de condamner les actes de violence. Elle réprime également l’omission d’agir, cette indifférence coupable qui peut sceller le sort d’une vie.
L’article 158 du Code pénal gabonais est clair : il sanctionne « quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, soit un fait qualifié de crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire ».
Les peines encourues au Gabon pour ce délit peuvent aller jusqu’à « cinq (5) ans d’emprisonnement et une amende d’un million de FCFA (1 000 000 FCFA) », voire plus selon la qualification des faits, si l’abstention est liée à un crime.
Ce délit est la parfaite incarnation du devoir de fraternité gravé dans notre droit. Il va au-delà des liens familiaux ou amicaux pour s’étendre à tout individu sur le territoire gabonais. Il rappelle que la citoyenneté active ne se limite pas au vote ou au paiement des impôts, mais s’exprime aussi dans les moments de vulnérabilité extrême d’autrui.
Malheureusement, au Gabon, plutôt que de tendre la main, d’appeler les secours ou de se rapprocher du poste de police le plus proche, de plus en plus de témoins préfèrent dégainer leur téléphone portable et filmer la détresse. Pis, certains rient de la victime. Ce phénomène, qui transforme l’urgence vitale en spectacle macabre pour les réseaux sociaux, révèle une inquiétante dérive morale et constitue une violation flagrante de la loi.
« C’est devenu un phénomène récurrent : allumer la caméra de son téléphone portable pour filmer tout ce qui se passe autour de nous, pour des vues sur le net ou avoir l’exclusivité, même si notre semblable est en situation de détresse », a indiqué Marguerite Otse, une compatriote.
Filmer, c’est choisir de devenir un spectateur passif et potentiellement un complice de la non-assistance. Il est temps de remettre la solidarité humaine au-dessus du buzz numérique.
Diffuser l’image d’une personne dans un état de vulnérabilité extrême constitue une atteinte grave à la dignité et à l’intimité de la victime, ce qui pourrait faire l’objet de poursuites pénales distinctes.
En substance, le droit gabonais nous rappelle que « si vous pouviez aider quelqu’un en danger sans vous mettre en péril, votre inaction est une faute contre la société ».
Cette disposition légale ne vise pas à transformer chaque citoyen en médecin, en policier ou en sauveteur professionnel, mais à garantir un filet de sécurité minimal dans la société, en faisant de la compassion une obligation légale. Elle est la reconnaissance que, dans les moments critiques, la vie humaine prime sur le droit de l’individu à l’indifférence.
Il est crucial de réaffirmer que le civisme passe par le geste, non par le clic. La loi gabonaise ne demande pas à chacun d’être un héros, mais d’être un citoyen responsable.