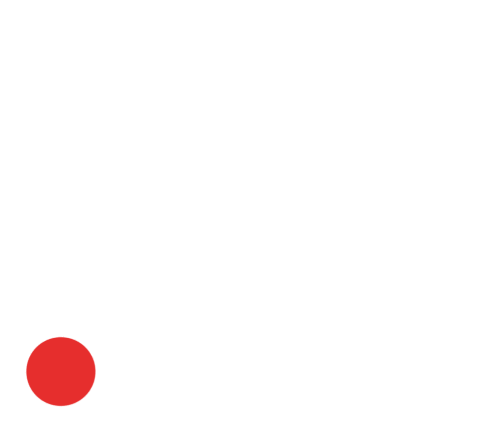Sur les réseaux sociaux, les mots blessent autant que les coups. Au Gabon, le harcèlement, ou ce que certains appellent ironiquement le “pressing”, prend des proportions inquiétantes. Entre moqueries, insultes et campagnes d’humiliation, la violence verbale s’est banalisée au point d’être perçue comme une simple expression de liberté d’opinion. Pourtant, le Code pénal gabonais, en son article 291 alinéa 3, est formel : ces comportements sont des délits passibles de jusqu’à deux ans de prison et cinq millions de francs CFA d’amende.
Sur internet, les dérives se multiplient. Une publication maladroite, une opinion impopulaire, un choix vestimentaire, et voilà des torrents de commentaires moqueurs, parfois d’une cruauté sans limites. « J’ai juste partagé une vidéo, et en quelques heures, j’ai reçu des centaines d’insultes. Certains m’ont même retrouvé sur WhatsApp pour continuer », raconte une jeune internaute de Libreville, encore choquée par cette expérience.
Ce type de témoignage n’est plus rare. À mesure que les réseaux sociaux s’imposent comme espace de débat public, la frontière entre critique et harcèlement s’efface. Les attaques ne visent plus seulement les personnalités publiques, mais aussi les citoyens ordinaires, souvent pour leur apparence, leurs opinions ou leurs origines. « Aujourd’hui, il suffit d’être différent pour devenir une cible », confie un sociologue, qui alerte sur « la culture du clash et de la dérision » qui s’installe dangereusement dans la société gabonaise.
Des conséquences lourdes et souvent invisibles
Les effets du harcèlement numérique dépassent largement l’écran. Isolement, anxiété, perte d’estime de soi, troubles du sommeil, etc. Les psychologues tirent la sonnette d’alarme. « On sous-estime l’impact émotionnel de ces violences répétées. Beaucoup de victimes développent de véritables syndromes post-traumatiques », explique une psychologue clinicienne à Libreville. Certaines victimes finissent par se retirer complètement des réseaux, d’autres sombrent dans la dépression.
Les jeunes sont particulièrement vulnérables. Dans les établissements scolaires, les moqueries en ligne deviennent le prolongement des brimades vécues dans les cours de récréation. « On fait des captures d’écran, on les partage dans des groupes privés, on rigole. Pour nous c’était drôle, mais aujourd’hui je me rends compte que c’était cruel », reconnaît un lycéen de la capitale.
Une loi claire, mais encore mal connue
Le Code pénal gabonais, à travers son article 291 alinéa 3, sanctionne tout acte de harcèlement. « Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, est puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus ».
Ces dispositions s’appliquent pleinement aux faits commis en ligne. Pourtant, nombre d’internautes ignorent encore la portée juridique de leurs actes. « Les gens pensent qu’internet est une zone sans loi, alors que les mêmes règles qu’ailleurs s’y appliquent », souligne RL. « Partager, insulter, humilier, ce sont des comportements qui peuvent détruire des vies et qui sont punissables », a-t-il ajoué.
Une responsabilité collective
Au-delà de la loi, c’est toute une éducation à la citoyenneté numérique qui reste à construire. La liberté d’expression, si précieuse, ne saurait justifier la haine ou la diffamation. Chacun doit apprendre à mesurer la portée de ses mots. « Internet donne une voix à tout le monde, mais ce pouvoir implique une responsabilité », rappelle un enseignant en communication sociale.
La lutte contre le harcèlement en ligne passe aussi par les plateformes elles-mêmes, appelées à renforcer leurs outils de signalement et leurs politiques de modération ou même mettre en place d’une police des réseaux sociaux. Mais l’action la plus décisive reste humaine : celle de refuser de relayer, de commenter ou de rire de ce qui humilie.
Une urgence morale et sociale
Dans un pays qui se veut attaché au respect, à la tolérance et à la cohésion, le cyberharcèlement représente une menace silencieuse, mais réelle, pour la paix sociale. Ses victimes n’en parlent pas toujours, mais elles portent les stigmates d’une violence quotidienne et invisible. Faire taire la haine en ligne, ce n’est pas restreindre la liberté d’expression, c’est la sauver.